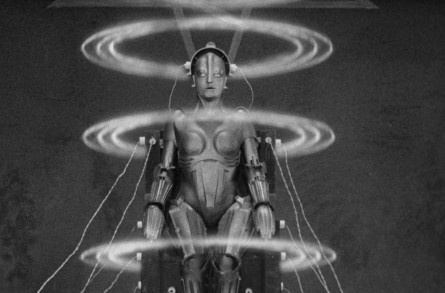Cette nouvelle rubrique propose une autre lecture d'un film sorti récemment, en faisant appel aux concepts et aux auteurs de la philosophie. Précédemment dans la rubrique :Soyez sympa, rembobinez de Michel Gondry De l'autre côté de Fatih Akin
A la fin de Funny Games USA, remake plan par plan de son film de 1997, Michael Haneke fait dire à l’un des "joueurs" que l’illusion est aussi importante que la réalité puisqu’elle a des effets sur elle. L’image n’en est pas seulement une, puisqu’elle nous marque, nous inspire des émotions, douces ou violentes, comme celles que suscitent les deux versions de Funny games. Dans ce(s) film(s), le réalisateur autrichien adopte à plusieurs reprises un procédé relativement rare : le "meneur du jeu" s’adresse au spectateur, le rendant implicitement responsable des horreurs à venir. Le spectateur ne veut-il pas une intrigue et une fin digne de ce nom ? Ce que nous regardons nous engage, semble dire le réalisateur. Mais sans doute, ce que nous ne voulons pas regarder nous engage tout autant.Prenant à parti le spectateur, Haneke lui rappelle avec brutalité que l’histoire à laquelle il adhère (puisqu’il la regarde et l’écoute) l’engage, laisse des traces sur lui. Ce ne sont pas seulement des images qui glissent sur lui. En fait, la question posée est celle de la puissance du virtuel. Dans Différence et répétition, Gilles Deleuze, s’appuyant sur Bergson (1859-1941), insiste sur la différence entre possible et virtuel. Le propre du virtuel est d’être à la fois différent du réel et dans le réel. Il n’est pas, contrairement au possible, en dehors de la réalité, mais à l’intérieur du réel. Dans le virtuel, il y a plus que le possible. Parce que l’actualisation du virtuel fait surgir la différence, la surprise.Le possible est comme l’explique Bergson, notamment dans La pensée et le mouvant (1934), une création rétrospective que l’on détache de la réalité. Une fois qu’un événement est arrivé, il est facile de dire qu’il était possible, qu’on pouvait en identifier des indices dans les conditions le précédant. Autrement dit, d’après Bergson, on reconstruit un possible, qui ne présente aucune surprise, qui ressemble parfaitement au réel que l’on a sous les yeux. Comme si la vie obéissait à un programme bien déterminé. Or, ce qui permet de la comprendre, ce n’est pas cette logique de la répétition, répétition du possible dans un réel lui correspondant parfaitement, mais, celle de la différence, celle du surgissement inattendu d’une réalité neuve. Le virtuel, c’est l’écart par rapport à ce qui précédait.Il y a toujours la possibilité de s’écarter des règles, de surprendre celui qui prétendait les poser. Lorsqu’Anna se saisit du fusil, c’est bien cette surprise du virtuel qu’elle rend visible. Mais Haneke pousse la logique de la surprise à ses extrêmes. On peut complètement changer les règles du jeu jusqu’à défaire le contrat tacite entre le réalisateur et le spectateur. C’est la fameuse scène de la télécommande, où le bourreau, voyant le rapport de force s’inverser après qu’Anna a tué son acolyte, décide de rembobiner la scène et de reprendre la main. Il n’y a pas de limites à la destruction que peut opérer cette surprise. On peut aussi se débarrasser sans préavis du personnage central, en le jetant par dessus bord, entre deux considérations annexes. Rien de ce "qui compte" n’est absolument respecté. Ce n’est pas seulement le postulat artificiel d’un cinéaste, c’est sa lecture du réel. Les règles qui nous rassurent sont illusoires. Nous nous y enfermons comme dans une belle demeure confortable, oubliant l’irrationnel, la violence qui tournent autour. Les choses peuvent toujours s’accélérer, se modifier, nous échapper. Il y a toujours la menace ou la richesse d’une ligne divergente qui surgirait, bouleversant notre existence. Dans Funny Games, Michael Haneke en explore la version la plus violente.
[Funny Games de Michael Haneke. 2007. Durée :1 h 51. Distribution : Les Films du Losange. Sortie le 23 avril 2008]