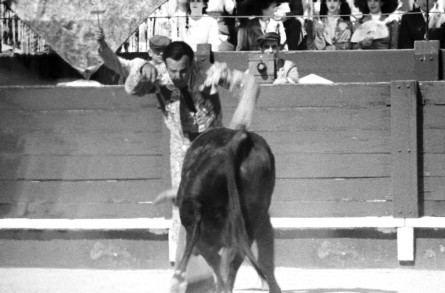Le « cinéaste le plus redouté de la planète » - c’est en tout cas ce qu’aime revendiquer Michael Moore - revient cette année avec Where to Invade Next, un documentaire militant et souvent drôle, mais qui n’évite pas la simplification outrancière propre au documentariste américain.
Le film s’ouvre pourtant sur une séquence très réussie. Dans ce premier chapitre, complètement fictif et particulièrement amusant, Michael Moore se rend au Pentagone. Sous couvert du plus grand secret, il y rencontre les chefs d’état-major, qui lui font part d'une préoccupation de taille : depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n'ont gagné aucune guerre. Michael Moore suggère alors d'octroyer aux armées américaines un repos bien mérité, et de l'envoyer, lui, en remplacement.
Voilà donc Moore parti en mission secrète, drapeau américain dans ses valises. Le but de l'opération est simple : « envahir » des pays européens et rapporter aux États-Unis les meilleures idées de chaque pays. Pendant deux heures, le spectateur suit donc Moore dans ses pérégrinations, accompagné par la voix off du documentariste. Toutes les séquences qui composent le film sont construites à l'identique : Moore débarque dans un pays, il choisit un thème d’étude (l'égalité hommes/femmes, la restauration scolaire, la prise en charge du stress des employés), révèle les mille et une merveilles des systèmes islandais, français, portugais, etc., puis plante son drapeau sur le sol du pays ainsi « envahi ». On apprend ainsi que les Italiens ont 8 semaines de congés payés par an, que les prisonniers norvégiens sont détenus dans des prisons 4 étoiles, ou encore que les étudiants slovènes peuvent accéder gratuitement à l’université…
Si l’on retrouve avec plaisir l’humour et la faconde de Moore, le plaisir s’émousse au fil des — trop nombreuses — séquences. Le film parcourt pas moins de 10 pays, et si les premiers chapitres obéissent à la règle « un pays, une idée », les segments suivants sont beaucoup plus brouillons. En Allemagne par exemple, cinquième pays « envahi », on passe sans transition du respect du temps de loisir des employés au devoir de mémoire.
De plus, l’idéalisation systématique des pays visités et le manque de rigueur de l’enquête deviennent rapidement gênantes. Michael Moore le dit lui-même, il ne cherche que « les fleurs, pas les mauvaises herbes ». Ce faisant, il oublie d’apporter les nuances qui rendraient son propos moins superficiel. En Italie par exemple, Moore établit une corrélation directe entre l’espérance de vie des habitants - en moyenne, un Italien vit quatre ans de plus qu’un Américain - et les nombreuses semaines de congés payés qui leur sont accordées. Car ce sont moins les pays qu’il visite qui intéressent Michael Moore que le miroir qu’ils tendent à l’Amérique. L’idée d’invasion positive est finalement le prétexte au portrait en creux, et au vitriol, d’un système américain entièrement dysfonctionnel : étudiants endettés, malbouffe institutionnalisée, salariés stressés, etc.
Ce manque de rigueur fait de Where to Invade Next un objet problématique sur le plan pédagogique, même si chaque chapitre, considéré indépendamment, présente un réel intérêt pédagogique pour ouvrir la réflexion (la séquence sur les prisons en Norvège pourra par exemple être le point de départ d’un débat en classe - « Comment punir sans détruire ? »). Le risque est que les élèves gobent de manière incrédule les idées réductrices assénées dans le film, et qu’ils sortent du cinéma mus par un anti-américanisme primaire. Cet écueil est regrettable, d’autant plus que cela ne semble pas être l’objectif de Moore. Tout au long du film, il ne cesse de répéter qu’il aime son pays et que toutes les idées formidables qu’il découvre pendant ses « invasions » sont, à l’origine, des inventions américaines.
Sa séquence finale dénote elle aussi d’un optimisme que le reste du film peine à transmettre. Revenu en Allemagne, Moore marche le long des restes du mur de Berlin, et s’émerveille de cette rupture historique : alors que le mur semblait être là pour toujours, il a tenu moins de 30 ans. Plus encore, il a suffit d’une seule nuit pour le faire tomber. Morale de l’histoire : les États-Unis, aussi mal en point qu’ils puissent apparaître dans l’oeil de Moore, peuvent encore changer, et plus rapidement qu’on ne le croit.