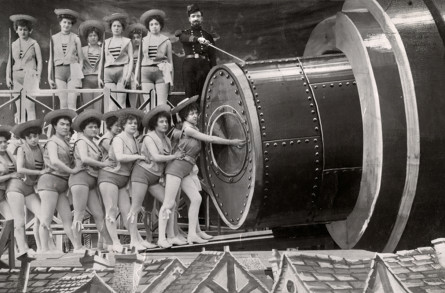Comment expliquer une telle précarité (des gens qui meurent de faim, d’autres qui ne peuvent pas se chauffer) au Royaume-Uni, cinquième puissance mondiale ?
Au Royaume-Uni, l’État-social s’est dégradé depuis 25-30 ans. La situation de ceux qui ne travaillent pas est donc aujourd’hui très critique : l’accès aux allocations sociales est extrêmement sélectif, les montants sont peu élevés, et il faut remplir de nombreuses conditions pour avoir droit à un revenu de compensation. On le voit bien dans le film.
Ce qui frappe dans Moi, Daniel Blake, c’est avant tout l’aspect kafakaïen du système d’aide sociale. Est-ce propre à la Grande-Bretagne ?
En France, lorsque l’on s’inscrit à l’aide sociale pour l’emploi, il y a des papiers à remplir, des renseignements à fournir, et les démarches sont parfois complexes. Mais on est encore loin des absurdités bureaucratiques du système anglais, telles qu’on les voit dans le film. Je pense à une scène en particulier : après avoir été notifié par courrier qu’il n’était pas éligible à la pension d’invalidité, Daniel Blake appelle l’administration. On lui indique qu’il ne peut pas faire appel tant que la personne en charge de son dossier ne l’a pas informé par téléphone de la décision. Alors qu’il est déjà au courant puisqu’il a reçu un courrier postal à ce sujet ! L’administration met en place des procédures absurdes, qui ne sont pas respectées par ses propres membres. Au final, le bénéficiaire est pris au piège d’une situation ubuesque. Une autre scène illustre bien les différences entre le système britannique et le système français. Daniel Blake est au job center [agence Pôle Emploi locale, ndlr], il doit faire une demande d’inscription en ligne. Incapable d’utiliser un ordinateur, il demande l’aide d’une conseillère bienveillante, mais celle-ci est immédiatement rattrapée et rabrouée par sa supérieure. Le système britannique demande aux chômeurs d’être autonomes, car cette autonomie est une preuve de leur motivation à retrouver un travail. En France ça ne se passe comme pas ça, l’assistance au numérique est un droit pour les personnes qui bénéficient de l’aide sociale.
L’histoire du service public britannique permet-elle de comprendre comment on en est arrivé à cette méfiance systématique envers les chômeurs ?
Le service public de l’emploi s’est construit autour du paradigme suivant : on pense que les efforts de recherche d’emploi finissent toujours pas payer, et que ceux qui n’y arrivent pas n’essayent pas vraiment. La priorité c’est donc de lutter contre ces « assistés » qui ne font aucun effort. Les dispositifs de protection sociale ont été construits de telle sorte qu’ils assurent un contrôle des chômeurs. En France, l’allocation chômage et les services associés viennent réparer un accident professionnel, dont les individus ne sont pas responsables. Au Royaume-Uni, le soupçon domine. Ainsi, le droit à l’emploi devient un devoir de travailler. C’est pour ça par exemple que les indemnités chômage sont indexés sur les situations familiales. Une femme qui est au chômage et dont le mari travaille verra ses allocations amputées. En France, ces indemnités sont attachées à la personne : elle a cotisé et a donc droit à ce revenu de compensation.
Il est aussi question dans le film des partenariats public-privé dans le secteur de l’aide sociale. Cette sous-traitance auprès d’opérateurs privés est-elle une tendance de plus en plus marquée dans les sociétés européennes ?
C’est un mouvement de fond qui a été initié en Grande-Bretagne mais qui concerne l’Europe toute entière. On assiste d’une part à une réduction du secteur public (baisse du nombre de fonctionnaires, baisse des dépenses publiques), et d’autre part à l’introduction de modes de gestion importés du privé (la culture de la performance notamment). Mais ce processus est plus ancien et plus radical au Royaume-Uni. Si l’on compare de nouveau avec la France, il est vrai que le service public de l’emploi français doit fournir des indicateurs de performance (le nombre de dossiers traités en une semaine par exemple). Mais ces indicateurs sont agrégés au niveau des agences, pas des agents, et servent à améliorer l’efficacité globale du service : on compare ces indicateurs entre les agences de profil similaire, afin d’identifier les bonnes pratiques et de les transplanter. En Grande-Bretagne, on fait peser la pression de ces indicateurs sur chacun des agents. Ces derniers doivent donc traiter plus de chômeurs et faire en sorte que ces chômeurs trouvent du travail coûte que coûte. Par ailleurs, ce qui est très frappant au Royaume-Uni, c’est, en plus du démantèlement du service public, le démantèlement de la notion même de service public. On le voit dans le film : les agents qui travaillent au job center dans lequel se rend Daniel Blake ne sont pas choqués par le fonctionnement kafkaïen de cette agence. L’absurdité est complètement intériorisée, et je ne pense pas qu’il y ait d’équivalent en Europe continentale. En France notamment, les syndicats sont des forces de résistance importantes face à cela. Mais en Grande-Bretagne, depuis le coup de boutoir de Thatcher contre le syndicat des mineurs au milieu des années 80, les syndicats du service public ont constamment été attaqués, jusqu’à disparaître complètement.
Ken Loach et son scénariste soulignent également l'image négative des chômeurs auprès de l’opinion publique britannique. Comment expliquer ce regard sur les chômeurs, corroboré par de nombreuses études ?
La suspicion latente envers les chômeurs est assez commune en Europe. C’est une caractéristique des sociétés dans lesquelles avoir un emploi est la norme de référence. En France, on le voit quand on fait des enquêtes sociologiques : même ceux qui ont connu le chômage pensent que, si l’on fait ce qu’il faut, il est possible de s’en sortir. Mais il y a aussi des éléments propres à la société britannique. D’une part, c’est une société qui glorifie très fortement la réussite individuelle. Comme aux États-Unis, l’opinion publique pense majoritairement que la réussite ne dépend que de soi. D’autre part, la société britannique est extrêmement cloisonnée. Le Royaume-Uni renvoie l’image d’un ilot de prospérité, avec des emplois à très forte valeur ajoutée qui attirent de nombreux travailleurs étrangers. Mais toute une partie de la population, celle qui ne peut pas obtenir ces emplois, vit dans un autre monde. Tandis que les services n’ont cessé de croitre, les emplois industriels ont tous été détruits. Il y a donc une segmentation très forte entre les différentes couches de la société, et également entre les régions (la région de Newcastle, dans laquelle se déroule le film, est une région déshéritée). À l’intérieur d’une même société, on a des populations qui vivent des trajectoires historiques inverses, ce qui, à mon avis, marque l’échec du projet de cohésion sociale.
Pourtant la Grande-Bretagne semble avoir bien traversé la crise de 2008. En novembre 2015, le taux de chômage est tombé à 5,1% de la population active, son niveau le plus bas depuis octobre 2005.
Cela montre que le taux de chômage est un indicateur limité. On utilise aujourd’hui le taux de chômage pour mesurer deux choses : l’état du marché du travail et le bien-être d’une population. Mais si l’on se concentre simplement sur la question du bien-être, on peut identifier plusieurs limites. Premièrement, il faut se poser la question suivante : à quelles conditions verse-t-on des revenus de compensation aux chômeurs ? Certains pays avec un taux de chômage plus élevé que le Royaume-Uni ont des populations plus heureuses car les chômeurs mieux accompagnés. Deuxième question : quels sont les revenus que peuvent espérer les travailleurs ? En Grande-Bretagne, certaines personnes ne sont pas au chômage mais ont des contrats de travail extrêmement précaires, qui ne leur permettent pas d’atteindre un bien-être économique. C’est le cas de China, le voisin de Daniel Blake, qui se plaint de son « job pourri » dont il ne connaît jamais les horaires à l’avance et qui ne lui permet pas de vivre. Donc le taux de chômage ne permet pas de tirer de conclusions définitives sur l’état d’une société.
Vous dîtes, dans une étude intitulée « Vivre le chômage, construire ses résistances » (parue en 2015), que les personnes au chômage ont toutes besoin d’un « truc » pour résister - s’occuper de sa famille, s’impliquer dans du bénévolat. C’est exactement ce que fait Daniel Blake dans le film, en prenant Katie et ses deux enfants sous son aile. Pourquoi est-ce si important ?
Pour Daniel Blake comme pour les chômeurs de la vie réelle, c’est une façon de lutter contre l’enfermement du chômage, qui est une situation obsédante (comment faire pour s’en sortir, comment faire pour survivre, ce sont des questions que l’on se pose en permanence quand on est au chômage). Ces relations - celle que Daniel Blake a avec Katie et ses enfants, mais aussi celle qu’il a avec son voisin, China - lui permettent également de redevenir quelqu’un. Le film montre que le chômage ne colonise pas toute sa vie : il continue à avoir des relations sociales, à sculpter le bois, etc. Le chômage n’est pas le tout de son identité, quand bien même l’institution cherche à lui faire croire cela. C’est montré de manière très cruelle dans le film : toutes les relations avec l’institution affirment l’absence de valeur de sa condition, elles lui font comprendre qu’il doit remplir le vide qu’est sa vie. Et lui est très lucide sur tout ça, c’est pour ça que le film est aussi fort. Quand Daniel Blake tague le mur de l’agence [il écrit, à la bombe : « Moi, Daniel Blake, demande une date d’appel avant de mourir de faim »], il exprime la nécessité, impérieuse, de réaffirmer son existence.
Aux États-Unis comme en France, on a assisté à l’éclosion de mouvements sociaux dénonçant la précarisation des travailleurs - Occupy Wall Street, Nuit Debout, les manifestations contre la Loi Travail. Trouve-t-on le même genre de mouvement au Royaume-Uni ?
À ma connaissance, il n’y a pas d’action collective autour de cette cause. Mais cela ne veut pas dire que tout est ramené à l’échelle individuelle. On le voit dans le film, des solidarités existent : China, le voisin de Daniel, l’aide à remplir sa déclaration sur Internet. Mais le chômage reste un objet non-politisé, toutes ces solidarités ont lieu dans des espaces privés.On le comprend au moment où Daniel Blake manifeste son existence dans l’espace public, avec le graffiti mentionné ci-dessus : les gens rigolent, applaudissent, mais personne ne s’approche de lui, personne ne vient s’opposer quand la police l’arrête. Il y a une frontière nette entre Daniel Blake et les gens qui le regardent.
Didier Demazière est sociologue, directeur de recherche au CNRS et membre du centre de sociologie des organisations de Sciences Po. Ses recherches portent notamment sur le chômage et les politiques publiques d’emploi. Parmi ses publications : Sociologie des chômeurs (La Découverte, 2006).