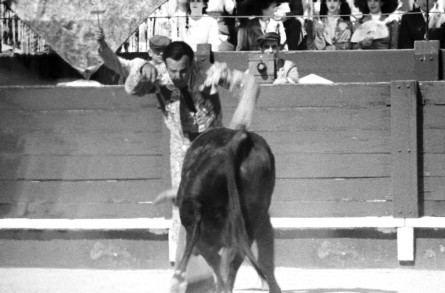La "fiction patrimoniale", genre qu’analysait récemment Raphaëlle Moine dans un article de TDC (TDC : Histoire au cinéma), a de beaux jours devant elle : trois mois à peine après le Molière de Laurent Tirard, voici le Jean de la Fontaine de Daniel Vigne. Est-ce l’écho, en cette année d’incertitude électorale, d’un besoin toujours plus pressant de "de contenir l'angoisse commune d'une discontinuité insensée, de procurer l'illusion de la pérennité en fixant le passé dans le présent" comme l’analysait la chercheuse ? Ou pour le dire plus crûment, de nous rassurer sur notre "identité nationale" en convoquant les deux écrivains les plus populaires du Grand Siècle (Racine, Corneille ou Boileau auront certainement plus de mal à interpeler les foules… et motiver les financiers) ? Alors que le film de Laurent Tirard mettait toute son énergie à "dépoussiérer le(s) classique(s)" en campant l’auteur de Dom Juan en jeune cancre débraillé (dépossédant au passage son œuvre de toute dimension politique), La Fontaine, le défi repeint le fabuliste en dissident avant l’heure. Comme si le cinéma n’aimait les écrivains que révoltés (rappelons-nous Beaumarchais, l’insolent d’Edouard Molinaro) contre l’ordre régnant, qu’il soit moral ou politique. Tout le film repose en effet sur l’affrontement manichéen entre le poète (Lorànt Deutsch) et le pouvoir, incarné par un Colbert (Philippe Torreton) tout de noir vêtu et machiavélique à souhait (dont chacune des apparitions est soulignée par une musique sinistre). Qu’est-ce qu’être artiste sous la monarchie absolue ? Telle est la question que pose le film. Il y répond en présentant deux voies : la première est celle qu’auraient suivie Molière, Racine, Boileau, se soumettant à l’ordre du Prince ; la seconde est celle qu’aurait empruntée La Fontaine, la résistance par la plume et la fidélité au mécène Nicolas Fouquet emprisonné par Louis XIV le 5 septembre 1661 après la fête somptueuse qu’il aura donnée le 17 août.Si le film respecte la biographie du poète (la fête de Vaux-le-Vicomte et la première représentation des Fâcheux de Molière, la rédaction de l’élégie aux nymphes de Vaux, l’exil à Château-Thierry, puis à Limoges, le service chez la duchesse d’Orléans, la publication des Fables), s’il ébauche une réflexion sur le travail de l’écrivain (bien absente du Molière de Tirard), en rappelant ses sources (Esope, l’observation des hommes et celle de la nature), on pourra regretter la constante tentation hagiographique qui consiste à mettre en scène l’écrivain comme le seul et unique opposant à Colbert et ses hommes de main.En lisant les œuvres de La Fontaine, on perçoit justement l’ambiguïté profonde du personnage : d’abord poète courtisan (le Songe de Vaux en témoigne), il sera comme moraliste loin d’être aussi révolutionnaire que le film ne le présente. Que penser en effet de la morale du Loup et l’Agneau : "La raison du plus fort est toujours la meilleure", si ce n’est qu’elle n’est qu’un conseil de prudence ? Pour vivre en paix, vivons loin des Grands et surtout ne discutons pas avec eux… On est loin du La Fontaine vieilli qui à la toute fin du film se contente de descendre les marches de Versailles à contre-courant de la masse des courtisans.Pour l'exploitation en classe (au lycée plutôt qu'au collège, car le film est très verbeux) on pourra se reporter au site Séance + du CRDP de Paris, qui propose vidéos téléchargeables, ressources, fiches d'activité, ainsi qu'au document Teledoc qui accompagne le documentaire Jean de la Fontaine, fidèle et rebelle diffusé ce soir sur France 5.
[Jean de la Fontaine, le défi de Daniel Vigne. 2006. Durée : 1 h 40. Distribution : Rezo films. Sortie le 18 avril 2007]