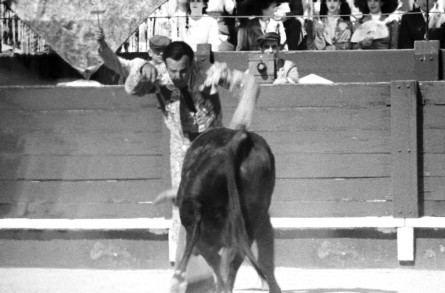Zérodeconduite : Dans quel contexte politique naît la Marche pour l’égalité et contre le racisme en 1983 ?
Abdellali Hajjat : Les socialistes ont gagné la Présidence de la République et l’Assemblée Nationale en 1981. Le champ politique se transforme et la gauche au pouvoir concentre beaucoup d’espoir. La politique du gouvernement est favorable aux étrangers et aux classes populaires : régularisations massives, suspension des expulsions pour les double-peines, instauration de la retraite à 60 ans, nationalisation des entreprises.... Cependant, le Front national réalise ses premiers succès à l’issue des élections municipales de mars 1983, et lors de l’élection municipale partielle de la ville de Dreux, en septembre. Le candidat frontiste accède au second tour face au candidat de la gauche.
Le film de Nabil Ben Yadir démarre sur fond de rébellions urbaines. Quelle en est l’origine ?
A.H. : Ces révoltes naissent à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise. Elles sont le fruit d’un conflit, toujours d’actualité, entre les jeunes des quartiers populaires (pas seulement les enfants d'immigrés) et la police. Les interventions policières, jugées violentes et injustes, déclenchent une contestation de l’autorité policière le 21 mars 1983 dans le quartier des Minguettes. Le préfet de police se retire pour éviter une escalade de la violence. La population adopte ensuite un mode d’action non violent et manifeste entre le quartier, la mairie de Vénissieux et le commissariat. Un groupe de jeunes, onze personnes, entame une grève de la faim le 28 mars pour protester contre la manière dont la mairie communiste, la police et les médias traitent les jeunes du quartier.
Le passage d’une lutte violente à une lutte non-violente permet ainsi le soutien de l’opinion publique ?
A.H. : Ces jeunes renversent leur image de délinquants et désarment symboliquement la police qui n’a pas les moyens de réprimer une grève de la faim ou une marche. Les modes d’action deviennent légitimes et les discours élaborés. L’alliance avec certaines associations de soutien aux travailleurs immigrés comme la Cimade et avec le prêtre Christian Delorme a rendu la Marche possible. Les jeunes s’étaient même fait entendre par le gouvernement puisque le directeur de cabinet du premier ministre, Dominique Figeat, se rend à la préfecture de Lyon le 7 avril 1983 pour négocier avec eux. La tension locale est, en partie, désamorcée par des promesses en matière d’emploi et la création d’une commission de prévention à la délinquance à laquelle les jeunes sont associés. Le noyau de grévistes de la faim fonde l’association SOS Avenir Minguettes, un interlocuteur viable pour discuter avec les pouvoirs publics. La journée du 20 juin 1983 bouleverse cet apaisement. Un policier tire sur le président de SOS Avenir Minguettes, Toumi Djaidja, alors qu’il était en train de secourir un jeune attaqué par le chien du policier. Il reçoit une balle dans l’abdomen qui ne le tue pas. A la suite de cet événement, lui et les autres membres de l’association décident de lancer la Marche pour l’égalité et contre le racisme qui se déroulera entre le 15 octobre et le 3 décembre 1983.
Quelles sont les revendications des marcheurs ?
A.H. : Premièrement, ils réclament l’égalité de traitement devant la police et la justice. Ils veulent en finir avec l’inégalité de traitement dans les peines encourues pour la petite délinquance et l’existence d’une certaine impunité pour des personnes accusées de crimes racistes (courtes peines de prison par rapport à la gravité des faits). Leur deuxième revendication porte sur le droit au travail. Les zones d’éducation prioritaires (ZEP) n’existaient pas encore et toute une génération d’enfants d’ouvriers, née dans les années 60, ne trouve pas de débouchés dans le monde de l’entreprise, la crise économique s’aggravant depuis les années 70. Une surpopulation juvénile se concentre au quartier des Minguettes et peu de structures encadrent cette jeunesse, que ce soit au niveau scolaire, sportif, professionnel ou associatif. La troisième revendication porte sur le droit au logement car une politique discriminatoire d’attribution des logements sociaux prévalait à l’époque. Les bailleurs sociaux et donc la mairie de Vénissieux refusaient d’attribuer certains logements sociaux à des familles maghrébines. Ces trois requêtes existaient déjà au moment de la grève de la faim au printemps 1983.
Qu’en est-il du rôle ambigu des Renseignements généraux (RG), vis à vis de La Marche tel que montré dans le film ?
A.H. : D'un point de vue historique, c’est une erreur. Il n’y a pas eu de volonté de sabotage. La Direction centrale des Renseignements généraux était au service du gouvernement qui lui-même avait une position empathique à l’égard des marcheurs. Georgina Dufoix, la secrétaire d’état chargée de la famille et de l’immigration de l’époque, avait envoyé une circulaire à toutes les préfectures des villes concernées par le passage de la marche pour ordonner aux services de police de veiller à ce que tout se passe bien. Les RG ont donc plutôt participé à une protection policière de Marseille jusqu’à Paris. Réaliser un film sur un fait historique induit forcément une distorsion de la réalité. La question est : à quel degré ? Il y a beaucoup de décalage par rapport aux personnages et certaines revendications qui n’ont jamais existé. En tant que socio-historien, je suis un mauvais spectateur, je me focalise sur les détails qui jurent avec la réalité historique…
Qu’ont pensé les immigrés de première génération de la Marche de 1983 ?
A.H. : Dans mon livre La Marche pour l’égalité et contre le racisme, je décris le lien qui existait entre les mobilisations des immigrés post coloniaux de première génération, dans les années 70, et celles de la génération de la marche, les enfants d’immigrés. L’alliance entre ces deux générations s’est concrétisée par des soutiens mutuels. Pendant les grèves de 1983-1984 de l’usine Talbot-Poissy, dans le Val d’Oise, les travailleurs immigrés étaient disqualifiés et peinaient à obtenir satisfaction. Ils luttaient contre les licenciements et pour améliorer leurs conditions de travail. En janvier 1984, une délégation de marcheurs et des comités d’accueil parisiens de la Marche s'est rendu chez Talbot pour les appuyer.
Zérodeconduite.net : Considérant les désillusions qui suivirent la marche, n’aurait-il pas été pertinent que le film traite de l’après-marche ?
A.H. : Le film se termine sur l’entrée des marcheurs à l’Elysée comme si cela avait été leur principale victoire. Toute une dimension de l’histoire n’apparaît pas mais ce sont des choix scénaristiques. A mon avis, un des objectifs de cette fiction consiste à réhabiliter un événement méconnu de l’histoire de France. Le film commence juste après que Toumi Djaidja se soit fait tirer dessus par un policier alors qu’une forte mobilisation existait avant et permet de mieux comprendre la décision des marcheurs. La Marche de 1983 fait actuellement l’objet d’une reconstruction qui révèle la volonté de certains artistes, enfants d’immigrés, que la France prenne en compte les enfants de l’immigration en tant que membres de la communauté nationale.
Quel est le contexte politique au lendemain de la Marche ?
A.H. : Pour la Cimade et SOS Avenir Minguettes, le but de la Marche était de recueillir une adhésion massive de l’opinion publique afin de donner des coudées franches au gouvernement pour mener une politique favorable aux étrangers. Suite à la percée du Front national aux élections municipales de 1983, le gouvernement considère qu’une partie de la population partage les idées du parti d’extrême droite. Avantager les étrangers pourrait lui coûter électoralement. Les marcheurs souhaitaient tordre le cou à cette croyance et prouver qu’il existait une France fraternelle. Après la Marche, ils obtiennent la carte de résident de 10 ans pour les étrangers, une revendication de longue date de la part du mouvement associatif pro-immigrés. Depuis 1972, une série de circulaires remettaient en cause la stabilité des étrangers sur le territoire français et rendaient l’obtention d’une carte de séjour et d’un permis de travail difficile. Cette carte offrait aux étrangers non communautaires la possibilité de se projeter dans l’avenir sans subir l’arbitraire administratif. Il y a eu un consensus lors du vote de la loi en juillet 1984. Même la droite, dirigée par Jacques Chirac avait voté pour.
Mais les lendemains ont vite déchanté…
A. H. : La plupart des marcheurs sont revenus dans leur quartier, notamment aux Minguettes et leur situation sociale n’a pas évolué. Certains ont réussi à s’en sortir en devenant entrepreneurs mais peu d’entre eux ont continué leurs activités associatives ou politiques. Les trois revendications de départ sur la question de la police-justice, le droit au logement et le droit au travail n’ont pas véritablement été traitées par les gouvernements successifs. Les tensions sociales n’ont cessé de s’accroître. Il y a eu une tendance à culturaliser le débat. Pendant et après la Marche, l’enjeu concernait la reconnaissance culturelle. De ce point de vue, les avancées sont notables puisque la Marche correspond symboliquement à l’apparition des enfants d’immigrés post coloniaux dans l’espace public. Auparavant, la figure de l’immigration était celle d’un homme seul qui travaille à l’usine et retourne ensuite dans son pays d’origine.
C’est pour cette raison que vous parlez de la Marche de 1983 comme le Mai 68 des enfants d’immigrés ?
A. H. : Cette marche correspond à une libération de la parole des enfants d’immigrés, une catégorie de la population stigmatisée. Ils font dès lors, l’objet d’un discours positif dans le monde et dans les médias. La Marche a provoqué une explosion du nombre d’associations dans les quartiers populaires entraînant la socialisation politique de milliers de jeunes. Du côté des élites, la tendance est de privilégier la dimension culturelle de la Marche, en occultant la question institutionnelle (police, travail, logement) et du côté de la population concernée, la Marche est une référence, considérée comme un événement fondateur permettant l’éclosion de toute une génération de militants. Il ne faut pas non plus surévaluer son importance dans l’histoire des familles d’immigration car très peu s’en souviennent.
Quel sens peut avoir cette marche et sa commémoration aujourd’hui ?
A. H. : La Marche pour l’égalité et contre le racisme pose une question politique, celle de l’égalité. Que signifie l’égalité au delà du discours généraliste et de la devise Liberté, Égalité, Fraternité ? Que signifie l’égalité dans le traitement vis à vis de la police et de la justice ? Comment faire en sorte qu’il n’y ait plus d’inégalités ou de discriminations notamment dans le monde du travail où elles s’aggravent ? Dans certaines zones urbaines sensibles, le taux de chômage des jeunes dépasse les 50%. La situation s’est détériorée depuis la Marche de 1983. Au delà du film, il s’agit du refus de l’égalité de la part de ceux qui sont dans des positions dominantes.
Sous quel angle les professeurs peuvent-ils aborder le sujet avec leurs élèves ?
A. H. : Les élèves peuvent s’interroger sur la définition du politique, de l’engagement, de la citoyenneté, de la construction des mobilisations et des rapports de force. Comment obliger les élites politiques et administratives à accorder une place à ceux qui sont dans des positions minoritaires ? Il est possible d’évoquer les révoltes survenues à Clichy-sous-Bois pendant l’automne 2005. La pomme de discorde concernait, à nouveau, une intervention policière. Il y a eu d’autres rébellions avant et après… La définition de la police peut constituer un thème de discussion entre professeurs et élèves. Que devrait-être une bonne police ? Comment les citoyens pourraient-ils contrôler les déviances policières ? Les jeunes pourraient réfléchir à un contrôle démocratique des activités policières, comme cela existe en Grande-Bretagne. En France, c’est un tabou. La proposition d’obliger les policiers à remettre un récépissé à l’issue de chaque contrôle a disparu après avoir suscité un vif débat. Cela renvoie à la légitimité de l’autorité policière, la reconnaissance des violences policières et à la difficulté qu’a la police à les reconnaître. Cela devrait être discuté collectivement dans les classes et dans le milieu politique. Si des solutions ne sont pas trouvées, les mêmes logiques d’exclusion risquent de se reproduire.
Que pensez-vous de l’essor du FN et l’omniprésence de l’Islam dans le débat public et dans les médias ?
A. H. : Dans notre ouvrage Islamophobie : comment les élites françaises fabriquent le "problème musulman", mon collègue Marwan Mohammed et moi-même tâchons de comprendre pourquoi le thème de l’Islam est devenu central dans le débat public notamment dans les écoles. Dans les années quatre-vingt, des études révèlent que les professeurs sont indifférents vis à vis du voile (hijab) que portent certaines jeunes filles à l’école. La première affaire du voile survient en 1989. Il se construit dès lors une opposition entre les bons "beurs", représentés par les marcheurs, et les "musulmans", dans un sens négatif et péjoratif. L’existence de pratiques religieuses musulmanes parmi les enfants d’immigrés apparaît comme un échec de l'intégration. Entre 1989 et 2003-2004 certains acteurs convainquent le gouvernement, les magistrats et les médias de légiférer. Des intellectuels comme Alain Finkielkraut et Régis Debray se sont mobilisés pour obtenir cette loi de prohibition du port du voile à l’école. Une enquête menée en 2008 par l’Institut National des Études Démographiques (INED) révèle que la reproduction des pratiques religieuses d’une génération à l’autre est plus importante chez les juifs et les musulmans que chez les catholiques. On observe une tendance à être plus attaché à une identité religieuse lorsqu’on se trouve dans une situation minoritaire. Mais ce phénomène sociologique est interprété comme un échec de l'intégration, un signe de la montée en puissance du fondamentalisme religieux. Le port du voile n’est pas considéré comme une pratique religieuse normale mais comme le symbole d’une appartenance à une mouvance politique. Certains intellectuels pensent que les enfants d’immigrés qui maintiennent les pratiques religieuses de leurs parents remettent en cause le modèle assimilationniste et l’homogénéité nationale. C’est le fond de l’affaire de 1989, avec le sentiment d'une trahison de la part des filles. Dans le discours républicain, les filles d’immigrés sont censées être à l’avant garde de l’intégration. La décision de ne pas adopter le modèle culturel dominant est perçue comme une trahison.
Comment le port du voile à l’école est devenu un problème national ?
A. H. : L’interprétation du port du voile comme une pratique non pas religieuse mais politique, ayant un lien avec un mouvment islamiste est une première raison. La deuxième raison s’explique par la mobilisation d’acteurs, notamment d’associations, de membres du Haut Conseil à l’intégration et du Parti socialiste. Une alliance s’est faite entre la droite, la gauche et des magistrats comme Rémy Schwartz qui était à l’époque au Conseil d’État. Cette alliance s’est cristallisée au moment de la commission Stasi (commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité, mise en place le 3 juillet 2003 par Jacques Chirac) et a légitimé l’idée d’interdire le port du hijab à l’école publique. Quelque chose qui était géré localement et ne posait pas de problème en 1989 est devenu un problème national en 2003. La troisième raison est une redéfinition de la laïcité. Historiquement la laïcité est issue de la loi de 1905 qui instaure la séparation de l’Église et de l’État. Cette loi établit le principe de neutralité de l’État à l’égard de n’importe quelle religion. Dans cette loi il y a aussi la garantie des libertés de culte et de conscience, et même de l’expression religieuse dans l’espace public. A partir des années deux mille, la laïcité a été redéfinie dans le sens de l’interdiction de la visibilité religieuse dans l’espace public. Des sondages révèlent qu’aujourd’hui si vous demandez à des enfants ou des lycéens ce qu’est la laïcité, ils répondront spontanément qu'elle concerne l’interdiction de signes religieux dans l’espace public. Alors qu’historiquement, la laïcité, ce n’est pas ça. Or la construction d’un problème et la redéfinition de la laïcité visent spécifiquement les musulmans. Il existe, par exemple, des processions religieuses catholiques dans beaucoup de villes françaises, qui ne posent aucun problème.
Pourquoi les musulmans ?
A. H. : Il faut remonter à leur origine sociale. Les musulmans sont majoritairement issus des classes populaires. L’islamophobie manifeste une contestation de la légitimité de l’immigration post coloniale sur le territoire français. Le signe religieux est utilisé pour justifier la remise en cause de cette légitimité. Les solutions qui sont proposées sont toujours des solutions d’exclusion. En 1989, au moment de la première affaire du voile, Pierre Bourdieu disait que la question patente était : "faut-il accepter le hijab à l’école publique ?", mais qu’elle occultait la question latente : "Doit-on accepter l’immigration nord-africaine en France ?" Cet enjeu existe toujours. L’islamophobie a tendance à réduire les individus à leur identité religieuse, censée poser problème à la collectivité. A l’école, le refus de certains enfants musulmans de manger du porc est considéré comme une remise en cause de la laïcité et de la République. La question de la compatibilité entre islam et république se pose si l'on admet que les deux seraient contradictoires. De nombreux pays à majorité musulmane ont instauré des régimes républicains : le Sénégal, la Turquie, la Malaisie… Ce sont des pays avec des élections démocratiques, représentatives, avec une alternance. La majorité musulmane n’empêche pas la mise en pratique de la démocratie. Le filtre islamophobe ne permet pas de saisir la complexité de la réalité sociale et de comprendre ce qu’est l’islam.
Quelle est la juste définition de l’islam ?
A. H. : "L’Islam" en général n’existe pas. Il y a une tendance à mettre en équivalence trois phénomènes distincts. Le premier est la pratique musulmane qui existe et se développe en France. Le deuxième est l’usage politique de la religion par des mouvements associatifs. Le troisième est l’utilisation de la violence physique au nom de la religion, autrement dit le terrorisme. Ces trois phénomènes sont étudiés séparément par des sciences sociales mais l’islamophobie tend à les relier comme s'ils constituaient une réalité unique. Comme si le fait de porter le voile était un signe d’appartenance à une association islamiste, qui elle-même préludait à un acte terroriste.
Pourquoi le débat se focalise sur l'Islam et la question du communautarisme, alors qu’en 1983, on parlait d’égalité de droits et de lutte contre le racisme ?
A.H. : Cela s’explique par plusieurs dynamiques qui relèvent du champ médiatique et du champ politique. L’Islam est devenu le marronnier de la presse. Les unes sur le sujet sont vendeuses. Sur le plan politique, depuis le début des années quatre-vingt, une convergence idéologique s’opère entre le parti socialiste et l’UMP du point de vue du programme économique. L’enjeu pour les acteurs politiques est de se distinguer notamment autour du thème de l’immigration. Une politique dure à l’encontre des immigrés perçus comme des étrangers compense l’absence d’une politique économique égalitariste, une juste redistribution des richesses. Il existe pourtant de nombreux Français de confession musulmane. Électoralement, le Parti socialiste et l’UMP considèrent qu’une politique d’immigration favorable aux étrangers leur porterait préjudice au profit du Front national.
D’où la légitimation des idées du Front national ?
A. H. : Les conseillers en communication et les instituts de sondage ont une vision fixe de cet électorat. Des études sociologiques démontrent néanmoins que ceux qui votent systématiquement pour ce parti sont peu nombreux. Parmi ceux qui ont voté pour l’extrême-droite le 21 avril 2002, seulement 3% d’entre eux avaient régulièrement voté FN, les dix années précédentes. Ce vote est flottant, versatile. L’analyse qu’en font les politiques est erronée. Les ouvriers et les classes populaires constitueraient l’électorat frontiste. Or le premier parti ouvrier est celui de l’abstention. Les ouvriers qui votent pour le Front national sont presque aussi nombreux que les cadres, les professions libérales, les artisans ou les commerçants qui votent pour le FN. La focalisation sur les ouvriers masque la diversité des profils sociaux de cet électorat. Les stratégies politiques consistent à stigmatiser les musulmans en espérant attirer les électeurs du Front national. En faisant cela, les politiques légitiment le discours d’extrême droite. Le lien entre la légitimation des idées du FN et la manière dont on interprète le succès de ce parti est manifeste.
Propos recueillis par Magali Bourrel
Abdellali Hajjat est sociologue, maître de conférences en sciences politiques à l’Université Paris-Ouest Nanterre et membre de l’Institut des sciences sociales du politique. Il a publié Islamophobie (avec Marwan Mohammed, La Découverte, 2013), Les Frontières de "l’identité nationale" (La Découverte, 2012), et co-dirigé Histoire politique des immigrations (post)coloniales (avec Ahmed Boubeker, éditions Amsterdam, 2008) ainsi qu'Engagements, rébellions et genre dans les quartiers populaires en Europe (1968-2005) (avec Sophie Béroud, Boris Gobille et Michelle Zancarini-Fournel, EAC, 2011). Son ouvrage La Marche pour l’égalité et contre le racisme (Amsterdam, 2013) s’interroge sur l’héritage de cette action initiée à l’automne 1983 par des jeunes du quartier des Minguettes à Vénissieux.